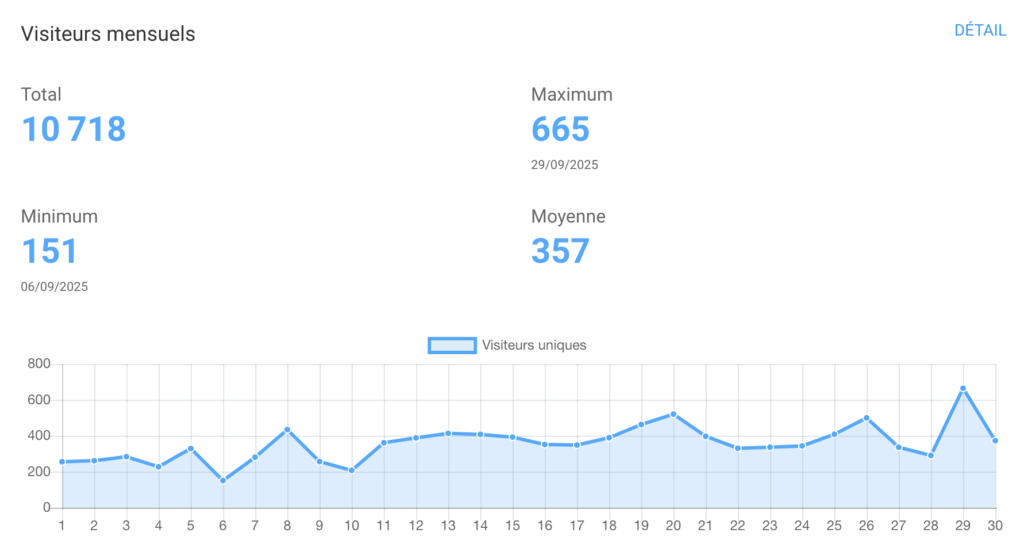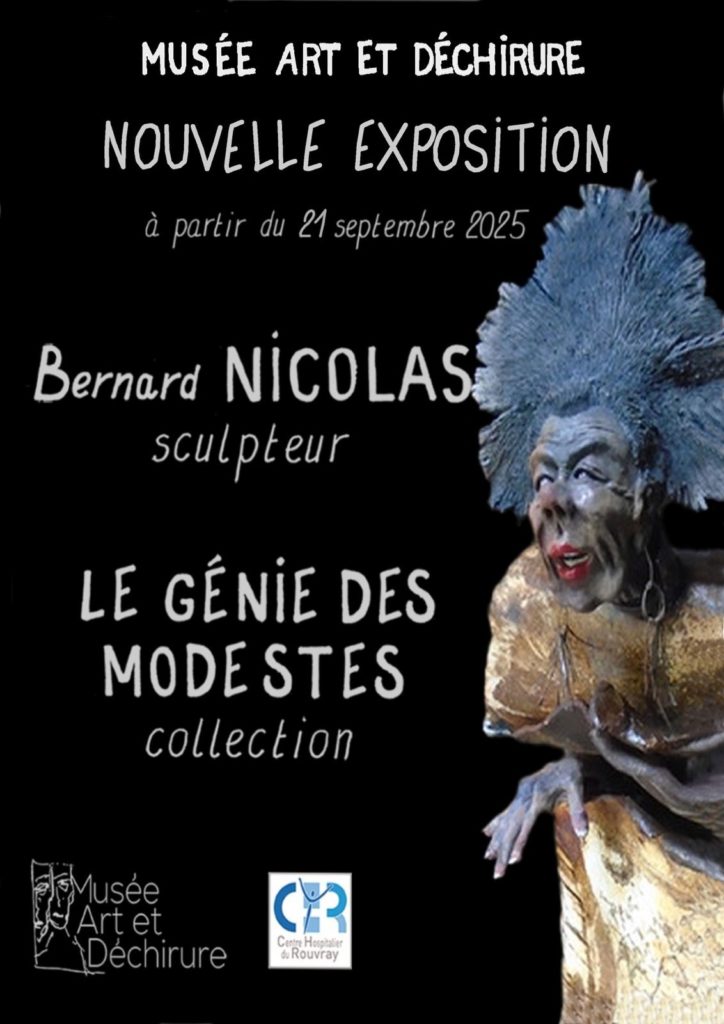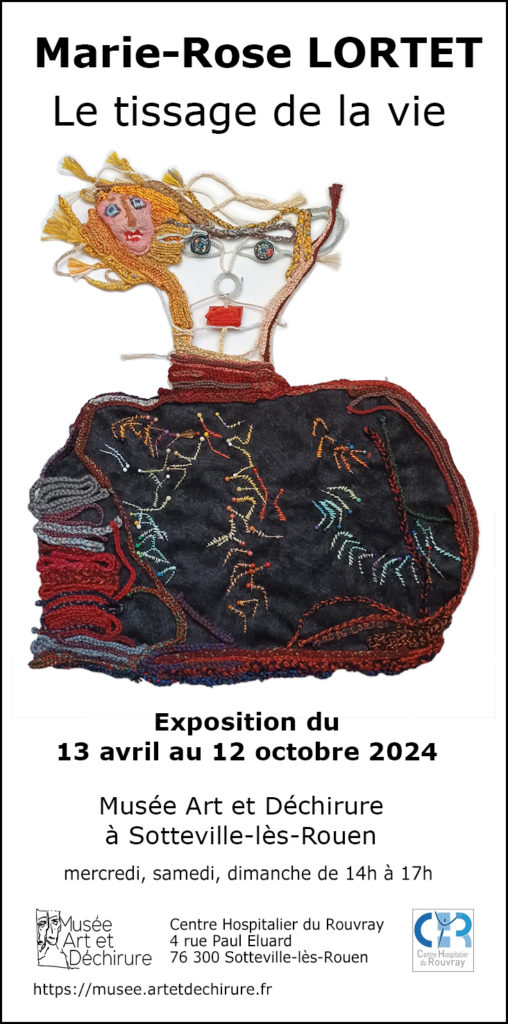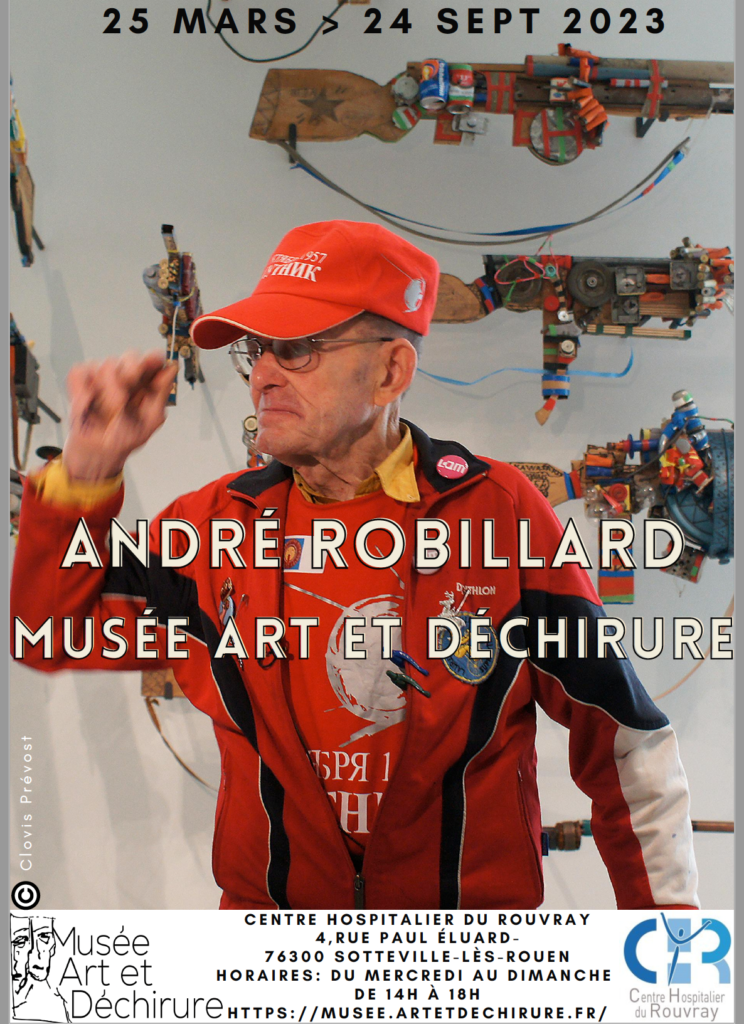Fanny FERRÉ
Fanny FERRÉ est née le 6 juin 1963 à Évreux (27). Elle étudie à l’École des Beaux Arts d’Angers puis à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris dans l’atelier de Georges Jeanclos.



Notice du catalogue du Festival Art et Déchirure 2019 :
LE SONGE D’UNE NUIT DE FANNY FERRE
« Allons, ma reine,
dans un grave silence,
courons après l’ombre de la nuit »
William Shakespeare
Partis pour toujours et sans jamais laisser d’adresse : les êtres qui naissent depuis un quart de siècle sous les doigts de Fanny Ferré ont définitivement adopté la grâce énigmatique des nomades. Façonnées comme par le vent, leurs silhouettes puissantes mais gracieuses, nimbées de longues chevelures et de rares oripeaux, n’en finissent pas de prendre le large. Toutes définissent la condition humaine tel un désir inassouvi d’ailleurs, sempiternellement dynamique. Ils ne fuient pas. Ils cheminent.
« Je cherche à ce que les personnages dégagent la vie » dit-elle. Les êtres élancés qu’elle façonnent à bras le corps mangent avec leurs doigts et vont nus pieds. Moins par souci de misère que par besoin de liberté : ils célèbrent les mouvements sans entraves et les moments sensuels, embaument le fruit sauvage, le pain chaud et le torrent d’altitude. Ils empoignent une charrette à bras, montent un cheval à cru. Allégorie de l’initiation ou de la protection, chacun de leurs gestes et des objets dont ils sont munis parait nécessaire, mais s’avère poétique. La fine terre chamottée employée par Fanny Ferré semble davantage pétrie de la poussière des étoiles que celle des bas-côtés.
Intemporelle et universelle mais rustique, leur tribu a pour caractéristiques morphologiques des attaches fines, permettant une grande souplesse, et des charpentes solides, aptes à la résistance. Et chaque nouvelle sculpture, variation de la précédente, est conçue tel le membre utile d’un groupe solidaire, intuitivement concerté. Comme les silences entre les notes d’une partition musicale, l’espace aménagé entre chaque œuvre, lors de sa mise en scène, engendre une profonde sensation d’harmonie.
Cette œuvre est résolument enchantée. Inspirées par la forêt, les nouvelles sculptures en témoignent particulièrement : panachés, auréolés de plumes ou de feuilles, parés de dépouilles de corbeaux ou de boucs, des personnages inédits surgissent. Fées en conciliabules ou chamanes envisagent des révélations, ils s’apprêtent et guettent. Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare et La Reine de la Nuit de Mozart, la Peau d’âne contée par Charles Perrault et les sabbats peints par Goya, les druides celtes et les sorciers africains, les ermites au désert et les yogis des montagnes, les tatouages punks et les dentelles néogothiques, tout cela et bien plus encore irrigue l’ensemble à la clarté lunaire qui s’impose désormais.
février 2016
Françoise MONNIN
Critique d’art – Rédactrice en chef de la revue ARTENSION
Notice du Musée Art et Déchirure (2017) :
Fanny FERRÉ est née le 6 juin 1963 à Évreux (Eure).
Son atelier est situé au Moulin de Bouvier dans l’Orne. Plus que tout autre sculpteur, Fanny Ferré exprime la vie et le mouvement. Ses personnages de terre marchent, courent, crient, soufflent, se désaltèrent, jouent avec les animaux, tirent une carriole, se baignent… Lorsqu’ils semblent statiques, c’est qu’ils se reposent du geste précédent, ou qu’ils font une sieste. Les gestes de leur vie quotidienne sont comme saisis « au vol » par l’artiste. Ces instants volés qu’elle nous donne à voir sont la signature inimitable de Fanny Ferré.
Personnages de terre et de bronze grandeur nature, saltimbanques, personnes déplacées, nomades du désert, migrants tout juste débarqués d’une plage de Méditerranée, hommes, femmes et enfants en marche vers un ailleurs, ils sont sans doute tout cela à la fois. Chaque spectateur y rencontre son propre rêve. Ces êtres dont on croit voir la chair frissonner nous sont terriblement proches car l’art de Fanny Ferré ce n’est pas que la représentation de la figure humaine, c’est l’humain tout court.